- Accueil
- Blog
Actualités Consommation
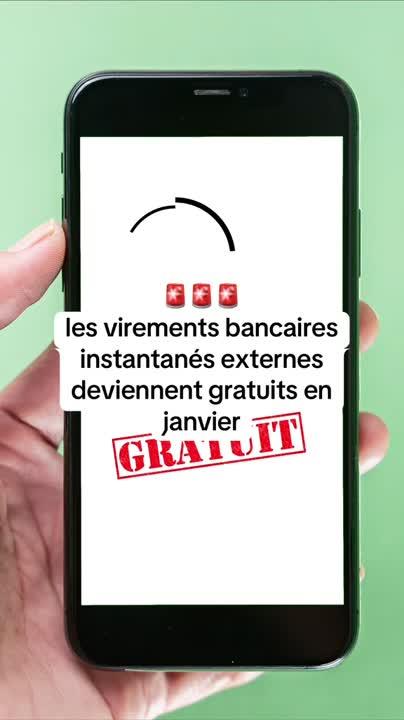
Le 19/01/2025
Les virements instantanés désormais gratuits
La gratuité des virements instantanés en euros s’applique dès aujourd’hui, permettant d’effectuer des transferts d’argent en moins de 10 secondes sans frais. Une évolution qui simplifie les paiements quotidiens, ouvre de nouvelles perspectives pour les particuliers mais doit inciter à la prudence dans un contexte d’arnaques financières exacerbé.
Il est rare qu’une disposition réglementaire, favorable aux consommateurs, s’applique en avance. C’est le cas ici. Attendue fin 2025-début 2026, la gratuité des virements instantanés en euros, c’est-à-dire en moins de 10 secondes, s’impose en France dès aujourd’hui. La gratuité des virements instantanés de compte à compte était déjà actée.
En revanche, jusqu’ici un grand nombre de banques continuaient de prélever un euro pour chaque virement extérieur instantané. De quoi décourager beaucoup de clients d’utiliser cette facilité pour les paiements quotidiens, entre particuliers, ou avec les commerçants.
Le 9 janvier 2025 au plus tard
C’est le règlement européen UE 2024/886 qui a accéléré le processus. Ce dernier dispose que les banques et prestataires proposant un service de paiement par virement doivent donner la possibilité aux utilisateurs de choisir le virement instantané dans les mêmes conditions financières qu’un virement classique. Or il se trouve que tous les établissements français proposent aujourd’hui cette dernière prestation gratuitement, si elle est réalisée en ligne. La date limite posée par le règlement pour mettre en œuvre la mesure est le 9 janvier 2025. Un certain nombre de banques ont déjà adopté la gratuité des virements instantanés dans leurs nouvelles conditions tarifaires, applicables au 1er janvier 2025. D’autres ont préféré retarder la mise en application à la date d’échéance. Les conditions tarifaires 2025 de la BNP indiquent ainsi : « Virement (cas d’un virement Sepa occasionnel), tarif applicable à partir du 09/01/2025 à tous les clients, avec ou sans offre groupée de services Esprit Libre : gratuit. »
Quoi qu’il en soit, à partir du 9 janvier, tout le monde est aligné sur la même obligation de gratuité. La réalisation d’un virement instantané en euros devra en outre devenir possible 24 heures sur 24, quel que soit le jour civil.
Applications utiles
Tous les types de virements sont concernés, qu’il s’agisse de virements entre particuliers (pour verser par exemple de l’argent à un enfant, à un ami, etc.), au bénéfice d’une entreprise ou d’une administration (commerçants, médecins, etc.), ou encore pour virer de l’argent de son compte bancaire à un compte ouvert dans un autre établissement (banque en ligne ou prestataire de paiement de type Paypal ou Lydia, etc.).
Le virement instantané est techniquement possible en France depuis 2018. Il constitue aujourd’hui l’un des piliers sur lesquels compte s’appuyer la future directive européenne sur les prestations de paiement (DSP2), qui entrera en vigueur en France en 2026. Il doit en effet permettre de régler les commerçants, notamment e-vendeurs, sans frais pour ces derniers, contrairement à la carte bancaire.
Pour les particuliers, le virement instantané présente d’autres avantages : disponibilité immédiate des fonds et grande souplesse de gestion de ses comptes. Il est ainsi possible, si l’on dispose de plusieurs comptes (par exemple l’un dans une banque et l’autre auprès d’une néobanque comme Revolut), de contourner les plafonds de paiement de la banque en se versant instantanément de l’argent sur un compte ouvert dans un autre établissement. Le virement instantané peut aussi désormais remplacer le chèque de banque. Le destinataire qui constate sur le champ le crédit sur son compte n’a pas besoin de sécurités supplémentaires.
Attention aux fraudes
Chaque nouvelle réglementation ou évolution, surtout financière, s’accompagne désormais de son lot de tentatives d’arnaque. La gratuité des virements instantanés ne devrait pas faire exception. Pour une raison simple : ce mode de paiement immédiat ne peut faire l’objet d’une quelconque annulation. Si vous êtes victime d’une arnaque (phishing, usurpation d’identité…) et que vous payez via un virement instantané, aucun rappel de fonds ne sera possible. Ce qui devrait motiver les escrocs du web à pousser leurs victimes vers ce mode de paiement, surtout que les banques autorisent des virements instantanés allant jusqu’à 15 000 €.
Dans un premier temps, en attendant de voir quelles mesures de sécurité vont éventuellement adopter les banques, mieux vaut les réserver à des proches ou des services de confiance et privilégier en cas de doute et de montant important le virement classique qui permet de revenir en arrière pendant les deux à trois jours du délai de traitement.

Le 12/12/2024
Depuis l’automne 2023, les clients du fournisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) Primagaz sont pénalisés par le changement de système d’information de l’entreprise : difficultés de livraison dans un premier temps, défaut d’activation ou de résiliation de contrats, compteurs non enregistrés, absence de factures, blocages de prélèvements, espace clientèle inaccessible, factures incompréhensibles ou excessives, non-remboursement de trop-perçus…
Au cours des douze derniers mois, ce sont plusieurs centaines de clients de Primagaz qui ont fait appel au médiateur national de l’énergie en raison d’un litige avec leur fournisseur, et de leurs difficultés à joindre le service client de l’entreprise pour le résoudre.
Compte tenu de la gravité de la situation, qui perdure sans amélioration notable, Olivier Challan Belval a adressé un courrier le 28 octobre 2024 (lire le courrier) au président-directeur général de Primagaz, Jan Schouwenaar, pour lui demander solennellement de prendre les mesures nécessaires et dédommager correctement ses clients lésés.
Dans sa réponse du 12 novembre (lire la réponse), ce dernier « regrette la mauvaise expérience » vécue par ses clients ces derniers mois, assure que les équipes de Primagaz sont « mobilisées pour le rétablissement d’un service de qualité », tout en regrettant que le médiateur national de l’énergie ne prenne pas en considération les difficultés de l’entreprise, et notamment « l’impact financier non négligeable » sur l’entreprise causé par les retards de facturation.
Considérant que Primagaz ne prend pas les justes mesures que ses clients sont en droit d’attendre pour être rétablis dans leurs droits, y compris lorsque le médiateur national de l’énergie est saisi d’une demande de médiation, Olivier Challan Belval a décidé de rendre publics les courriers d’échanges avec Primagaz.
Il demande à la direction de Primagaz de renforcer les moyens mis en œuvre pour que tous les problèmes de facturation de ses clients soient réglés avant la fin de l’année, qu’ils soient dédommagés à hauteur de leur préjudice, et que des facilités de paiement leur soient accordées quand ils en ont besoin.
Source : site du Médiateur de l’Energie

Le 30/11/2024
Agirc-Arrco : deux services gratuits pour les retraités de 75 ans et plus !
L’Agirc-Arrco permet aux personnes de 75 ans et plus en situation de fragilité d’accéder à une aide à domicile momentanée et d’un accompagnement pour leurs sorties. Ces deux services sont entièrement pris en charge par la caisse de retraite complémentaire. Les bénéficiaires n’ont donc rien à payer.
Outre le versement d'une retraite complémentaire, les cotisations à l'Agirc-Arrco donnent accès aux personnes de 75 ans et plus à un ensemble de services intégralement pris par la caisse. Les bénéficiaires n’ont donc rien à avancer, ni de reste à charge à régler. Et bien sûr, cela n'aura aucun impact sur le montant de leur pension.
Un forfait de 300 € pour être accompagné lors des sorties
Proposé par la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco, le service «Sortir plus» permet aux personnes de 75 ans et plus en situation de fragilité (isolement, âge, difficulté à se déplacer) de bénéficier d'un transport accompagné pour tous types de déplacements. Et ce, qu’il s’agisse d’aller faire des courses, de rendre visite à des amis ou de se rendre au restaurant...
Les sorties sont intégralement prises en charge par la caisse Agirc-Arrco dans la limite de 300 € pour 2024 et pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le coût de la sortie est fixé en fonction de la durée et de la distance à parcourir.
Pour bénéficier de «Sortir plus» et l'aide à domicile temporaire, il suffit de demande l'ouverture d'un compte par téléphone au 0 971 090 971 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, hors jours fériés) ou via le site de l'Agirc-Arrco.
Une fois la nature de la demande précisée (véhiculée ou non, durée, distance…), un conseiller se charge de trouver un accompagnateur membre d'une structure d'aide à domicile et de régler les détails financiers.
Le mieux est d'appeler le téléconseiller au moins 2 jours à l'avance.
À l'heure convenue, l'accompagnant vient chercher le demandeur et selon les cas, il peut l'attendre ou rester à ses côtés. Il le raccompagne ensuite à son domicile.
Jusqu’à 10 heures d’aide à domicile momentanée
L'Agirc-Arrco propose également aux personnes âgées une aide à domicile momentanée pour leur permettre d'assumer leurs tâches quotidiennes (courses, ménage, préparation de repas…) lorsqu'elles font face à des difficultés passagères : absence ponctuelle d'un proche, maladie temporaire…
Le nombre d'heure attribuable dans le cadre de l'aide momentanée à domicile est limité à 10 heures réparties sur 6 semaines maximum.
Pour en bénéficier, il faut être retraité de l'Agirc-Arrco, avoir au moins 75 ans et ne pas bénéficier de plans d'aide personnalisé comme l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) ou de plan Oscar (Offre de services coordonnée pour l'accompagnement de ma retraite).
Comme pour «Sortir plus», la demande doit se faire par téléphone au 0 971 090 971 ou via le site de l'Agirc-Arrco. Un conseiller en ligne les aidera à définir le type d'aide nécessaire (aide aux courses, repas, aide au ménage, aide à la personne…) et lui indiquera le nombre d'heures d'aide qui lui est attribué.
Sous 48 heures, un professionnel d'un organisme d'aide à domicile agréé par l'Agirc-Arrco peut se rendre au domicile de la personne pour l'aider en fonction de ses besoins.
Source : Le Particulier novembre 2024

Le 09/11/2024
Arnaques à la location immobilière
Les escrocs ont plus d’un tour dans leur sac et l’un d’entre eux est l’arnaque à la location immobilière. Son but : soutirer de l’argent à un candidat locataire, mais aussi des informations personnelles et des documents d’identité pour en faire un usage frauduleux, tel que la souscription d’un crédit à la consommation.
Dans ce type d’arnaque, les escrocs se font généralement passer pour un propriétaire ou un bailleur attirant leurs futures victimes grâce à une fausse annonce crédible.
Une fois le candidat à la location appâté, comment opère le faux propriétaire ?
Généralement, il demande de fournir par mail les éléments nécessaires à la constitution d’un dossier de location classique et parfois même le versement d’une somme d’argent, justifiée au titre du dépôt de garantie, de caution ou encore d’arrhes pour "réserver" le bien. Il justifie cette demande en indiquant qu’il ne réside pas sur place, ou bien qu’il ne souhaite pas se déplacer inutilement, ou encore qu’il a besoin de s’assurer de l’intérêt de la victime pour le logement.
L’un des premiers réflexes, c’est de se méfier des annonces trop alléchantes, car elles peuvent souvent cacher un escroc. Si le propriétaire ou l’agent immobilier invoque des prétextes pour éviter ou reporter la visite des lieux, méfiez-vous aussi.
Vous avez raison ! Par ailleurs, n’envoyez jamais de copies de documents d’identité sans les avoir marqués. Inscrivez le motif de l’envoi, la date et le destinataire pour éviter qu'ils ne soient réutilisés pour usurper votre identité. À cette fin, le site Filigrane Facile peut vous aider à marquer vos documents/justificatifs numériques, en les recouvrant d'un filigrane.
Refusez tout paiement vers des comptes bancaires à l’étranger, tout règlement en espèces ou par des services de transfert d’argent, surtout avant d’avoir signé votre bail. Et au moindre doute, demandez au propriétaire une copie de la taxe foncière pour vous assurer que le logement proposé à la location est bien à lui.
Si vous êtes victime, déposez une plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, ou encore par écrit au Procureur de la République du tribunal judiciaire dont vous dépendez.
Sachez qu’il existe également la plateforme dédiée THESEE, qui permet de déposer une plainte pour ce type d’escroquerie.
Pour tout conseil ou besoin d’assistance, n’hésitez pas à vous rendre sur la plate-forme Cybermalveillance.gouv.fr.
Source : INC Octobre 2024

Le 22/10/2024
Sniper 1000, l’insecticide mortel qui inquiète les autorités
Interdit depuis 2013, ce produit anti-punaises de lit est toujours vendu illégalement. Douanes et Répression des fraudes alertent sur ses dangers.
Depuis début 2024, les services douaniers déclarent avoir saisi 2271 flacons de Sniper 1000 EC DDVP, un insecticide contenant du dichlorvos. Cette substance est pourtant interdite en France comme produit phytopharmaceutique depuis 2007 et comme biocide insecticide depuis 2013.
Non seulement des flacons de Sniper 1000 sont encore en circulation (ou de Shooter 1000, autre nom commercial du dichlorvos) mais les saisies augmentent. Celles des douanes en 2024 représentent près de cinq fois le volume des saisies de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en 2023. Une partie a été retrouvée dans deux colis postaux et dans une cargaison débarquée à l’aéroport de Roissy, mais l’essentiel provient des bagages de voyageurs.
Pourquoi cet insecticide est-il soudain tant prisé ? Parce qu’il lutte contre les punaises de lit, dont les infestations sont en recrudescence depuis plusieurs années. Problème : il est très toxique aussi pour les humains.
Le Sniper 1000 est mortel par inhalation
Classé comme mortel par inhalation et toxique par contact cutané ou par ingestion, il peut provoquer des symptômes respiratoires de type asthmatiforme, des symptômes oculaires, des troubles neurologiques pouvant conduire à une perte de connaissance ou encore entraîner une allergie cutanée.
Fin 2023, ce sont les Centres antipoison et l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) qui alertaient sur ses dangers. Entre janvier 2018 et 2023, ils avaient recensé 163 cas d’intoxication en lien avec le Sniper 1000. La plupart étaient sans gravité, mais 10 % ont été jugés de gravité moyenne et 5,5 % de gravité forte. Trois personnes sont décédées (décès accidentels ou après ingestion volontaire), d’après le rapport de toxicovigilance.
Parallèlement, la DGCCRF avait alors lancé la campagne de rappel du Sniper 1000 toujours active sur RappelConso.
Les bons réflexes contre les punaises de lit
Pour lutter contre les punaises de lit sans s’intoxiquer, le gouvernement incite, par la voix de l’Anses ou de la DGCCRF, à privilégier en première intention les solutions mécaniques et thermiques avant les solutions biocides et recommande de contacter un professionnel référencé sur le site stop-punaises.gouv.fr.
La DGCCRF met également à disposition des consommateurs une fiche pratique. Enfin, les Agences départementales pour l’information sur le logement (ADIL) ont mis en place un numéro d’assistance téléphonique dédié pour expliquer les démarches à effectuer : 0806 706 806.
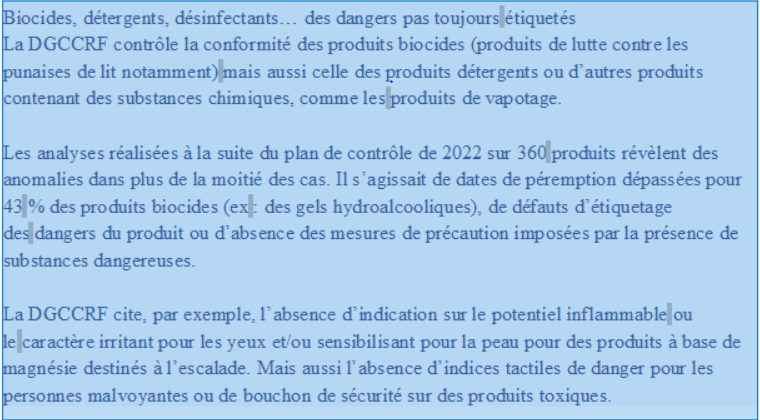

Le 11/10/2024
Arnaque téléphonique
La lutte contre le spoofing avance
À partir du 1er octobre, les opérateurs téléphoniques ont l’obligation de bloquer les appels dont le numéro affiché n’a pu être authentifié. Ces nouvelles dispositions visent à lutter contre le spoofing, procédé qui permet d’afficher un autre numéro que celui de l’appelant, très prisé par les escrocs, notamment pour l’arnaque au faux conseiller bancaire, ravageuse et très répandue.
Le spoofing, c’est fini ? Les nouvelles obligations qui incombent aux opérateurs téléphoniques portent à le croire. Elles servent en effet à combattre cette technique qui permet à des escrocs d’afficher un numéro de téléphone usurpé, l’appelant pouvant ainsi tromper son interlocuteur sur son identité. Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans le cadre de la loi dite Naegelen (loi n° 2020901 du 24 juillet 2020), qui vise à encadrer le démarchage téléphonique et lutter contre les appels frauduleux.
Ainsi, à partir du 1er octobre, l’ensemble des opérateurs en France ont l’obligation de couper les appels non conformes, c’est-à-dire dont le numéro n’a pu être authentifié. Pour ce faire, ils ont dû, depuis le 1er juin, mettre en place un mécanisme d’authentification du numéro (MAN). Les appels frauduleux seront ainsi interrompus, évitant aux potentielles victimes de recevoir l’appel.
Ces mesures s’attaquent principalement à l’arnaque au faux conseiller bancaire, qui repose principalement sur cette technique d’usurpation du numéro et continue de faire des ravages. Plus globalement, selon le dernier rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, les « fraudes par manipulation », dont celle au faux conseiller bancaire fait partie, ont représenté 379 millions d’euros en 2023, pour un montant total de fraude au paiement de 1,195 milliard d’euros.
Seuls les téléphones fixes sont concernés:
Si cette loi fait un pas en avant dans la lutte contre la fraude aux moyens de paiement, elle ne concerne pour l’instant que « les appels passés depuis ou à destination des lignes fixes », alors que la plupart des appels illicites sont émis vers des téléphones portables. Cependant, la Banque de France assure que « dans la quasi-totalité des cas de spoofing bancaire qui nous sont rapportés, c’est bien un numéro de ligne fixe qui est usurpé, car ce sont les numéros les plus facilement identifiables par les fraudeurs comme par les victimes. Le mécanisme sera donc efficace, même quand l’appel sera à destination du mobile de la victime ». La réponse à partir du 1er octobre !

Le 26/09/2024
Scandale des eaux en bouteille
La justice ne se mouille pas en optant pour une convention !
En début d’année, un double scandale a éclaboussé Nestlé Waters qui procédait à un traitement interdit des eaux pour les vendre en bouteilles et à des forages illégaux. Le Parquet a choisi de s’engager, non pas dans des poursuites pénales mais dans une négociation avec Nestlé par une procédure de « convention judiciaire d’intérêt public » - un ersatz de « plaider coupable » - que le Tribunal judiciaire d’Épinal a homologué cet après-midi à l’issue d’une audience à laquelle l’UFC-Que Choisir était présente.
Pour rappel, des pratiques scandaleuses dissimulées depuis de nombreuses années avaient été révélées début 2024 : des industriels, parmi lesquels Nestlé Waters, auraient eu recours à des systèmes de purification interdits afin de poursuivre la commercialisation d’eaux en bouteille… sans pour autant renoncer comme cela aurait dû être le cas à les vendre comme étant des eaux « naturelles ». L’UFC-Que Choisir s’étant immédiatement constituée partie civile, le parquet nous a finalement contactés, au cœur de l’été, pour indiquer qu’il s’orientait vers une « convention judiciaire d’intérêt public », autrement dit une procédure opaque, permettant à Nestlé Waters d’échapper à un long procès, pourtant mérité et utile au regard de la gravité, de la durée et de l’impact des faits… Le Procureur en a donc décidé autrement et ce choix était insusceptible d’un quelconque recours.
Si elle suppose la reconnaissance de l’existence des faits par l’entreprise, la « convention judiciaire d’intérêt public » ne la déclare pas, pour autant, coupable et sa validation par le juge fait ensuite obstacle à toutes autres poursuites pénales sur les faits concernés (que ce soit d’ailleurs à l’initiative du procureur ou même des victimes), sans prévoir de voie de recours pour les victimes qui doivent donc tenter de se faire entendre, sans débat, dans le cadre de cette seule procédure.
Alors : en être ou non ? Là était toute la question… Bien que fortement tentés de ne pas répondre aux sollicitations du Procureur, nous nous sommes refusés à toute opposition dogmatique afin de ne pas sacrifier la voix et les intérêts des consommateurs, surtout avec le risque que, faute de représentants de la société civile, Nestlé Waters n’ait pas à répondre pécuniairement de l’atteinte ainsi causée, par ses pratiques, à l’intérêt collectif.
Ce serait mentir de dire que nous sommes satisfaits de l’issue choisie par le Parquet pour éteindre ce scandale.
La validation de cette convention entérine néanmoins le fait que Nestlé Waters, à défaut d’être condamnée pénalement, devra verser une amende d’intérêt public de 2 millions d’euros, se conformer à des obligations correctives pour la restauration du milieu à hauteur d’un million d’euros, outre le versement d’indemnités pour les préjudices invoqués par les différentes associations s’étant constituées, dont l’UFC-Que Choisir, pour une somme globale de 500 000 euros. Soit un chèque total d’un peu moins de 4 millions d’euros…
La morale de cette histoire ? Dans une procédure créée pour se dérouler sans « vous », monter dans le seul train qui passe, à défaut d’être satisfaisant, est la seule solution possible car moins il y a de passagers, plus l’entreprise visée s’en tire à bon compte ! En tout cas, cela souligne, s’il en était encore besoin, les limites actuelles et malheureuses de la Justice en France.




