- Accueil
- Blog
Actualités Consommation

Le 13/05/2023
Six astuces pour repérer un site Internet louche
Il n’est pas toujours facile de savoir si un site web marchand est digne de confiance. Pourtant, quelques détails doivent vous alerter. Nos conseils.
Ce site Internet est-il fiable ? Pour répondre à cette question, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s’est dotée, depuis le 30 décembre dernier, d’un nouveau pouvoir, le name and shame (« nommer publiquement et faire honte », en français), qui permet de pointer du doigt une entreprise coupable de mauvaises pratiques.
Le gendarme de la consommation peut maintenant diffuser des injonctions prises à l’encontre d’un site web fautif sur divers supports (presse, affichage en magasin, sur les réseaux sociaux…), y compris sur le site du commerçant et aux frais de ce dernier afin d’avertir les consommateurs. « La publication de ce communiqué prendra la forme d’une bannière fixe placée dans la partie supérieure de la fenêtre de navigation du site à laquelle a accès l’internaute », nous précise le cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et au tourisme.
Mais cette bannière ne vaut que pour les commerçants rattrapés par la patrouille. Or, certains sites sont de pures arnaques. Pour éviter de tomber dans le piège, suivez nos conseils.
1. Gare aux ristournes trop importantes
Sur le Net, c’est souvent moins cher. Mais restez vigilant. Un article est vendu avec une réduction de 90 % ? Si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement louche. Vous avez toutes les chances de vous faire arnaquer en ne réceptionnant jamais votre commande ou en constatant qu’au prix affiché se greffent de multiples frais dont un coût d’expédition extravagant.
2. Vérifiez la présence des mentions légales
En France, les sites web ont l’obligation d’afficher des mentions légales (article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique). Elles comportent, entre autres, l’identité du professionnel, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), la dénomination sociale, la forme juridique ou encore le numéro d’identification à la TVA, l’adresse postale, l’adresse mail.
Un lien permettant d’accéder aux mentions légales figure en général au bas de la page d’accueil du site ou dans les conditions générales de vente (CGV). En leur absence, ou si elles sont incomplètes, méfiance. En cas de doute, faites une recherche dans la base officielle Whois en indiquant l’adresse du site web. Vous obtiendrez alors des informations sur le propriétaire du site et sa date de création. Si le site est très récent, c’est peut-être un piège. Notez que ce n’est pas parce qu’un site est en .fr qu’il s’agit d’un site français !
3. Contrôlez le niveau de sécurité
Restez attentif au niveau de sécurité du site marchand. Vérifiez la présence d’un petit cadenas devant l’adresse du site dans la barre d’adresse de votre navigateur. Il signifie que le site utilise le HTTPS (protocole de transfert hypertextuel sécurisé) qui garantit, grâce à un chiffrement, la sécurité et la confidentialité des données échangées entre votre ordinateur et le site web contacté.
S’il n’y a pas de cadenas, les informations que vous indiquez (nom, prénom, numéro de téléphone ou de carte bancaire, etc.) sont transmises en clair et susceptibles d’être interceptées par n’importe qui. Dans ce cas, abstenez-vous de remplir tout formulaire avec des informations sensibles et, encore moins, d’y effectuer un achat.
Mais la présence du cadenas ne suffit pas à attester à 100 % de la sécurité du site. Si vous avez un doute, demandez à Safe Browsing de Google. Ce service gratuit permet de vérifier le niveau de sécurité en y indiquant son adresse. Il vous informera si, à sa connaissance, le site est sécurisé, s’il a été infecté ou s’il propage des logiciels malveillants.
4. Lisez bien les conditions générales de vente
En France, tous les sites proposant des biens ou des services aux particuliers doivent fournir de nombreuses informations préalables (article L. 221-5 du code de la consommation) : description du produit, prix, garanties, modalités de livraison, conditions relatives au droit de rétractation, etc. L’absence de ces informations, regroupées par exemple dans les conditions générales de vente (CGV), est un signal clair du manque de fiabilité du commerçant. Lisez-les attentivement si vous souhaitez acheter sur un site que vous ne connaissez pas.
5. Examinez l’orthographe et la mise en page
Dès la page d’accueil, le site maltraite la langue française ? Ses images sont floues, pixélisées ou mal cadrées ? Ces détails doivent vous interpeller, car le site marchand n’est peut-être simplement qu’une façade et ne vend que du vent.
6. Consultez les avis des internautes
Si vous avez un doute, vous n’êtes probablement pas le seul. Dans ce cas, allez voir ce qu’en pensent les autres consommateurs en tapant dans un moteur de recherche le nom du site suivi du terme « arnaque ». Si les commentaires négatifs affluent, c’est qu’il y a un loup.
Vous pouvez également consulter Trustpilot, qui attribue des notes aux sites web à l’aide d’avis vérifiés d’utilisateurs. Enfin, un petit tour sur Signal-Arnaques vous permet de vérifier que le site marchand n’est pas déjà la cible de signalements.
Source : 60 Millions de consommateurs

Le 11/05/2023
Que faire en cas de litige avec votre complémentaire santé ?
Votre mutuelle joue la montre lorsqu’il s’agit de résilier, de rembourser ou d’appliquer les garanties promises ? Voici comment agir.
« Que faire si je ne suis pas d’accord avec le montant de mes remboursements ? »
Premier réflexe : laissez toujours une trace écrite et datée, de votre demande – courriers, mails, captures d’écran pour les formulaires. C’est elle qui fera foi en cas de contestation. Si la demande exprimée auprès de votre conseiller n’aboutit pas, suivez la procédure qui figure sur votre contrat ou sur le site Internet. Elle consiste, en général, à saisir le service réclamations, parfois un conciliateur interne et, en cas d’échec et au moins deux mois après votre réclamation, le médiateur. Il en existe trois : le médiateur de l’assurance, le médiateur de la mutualité française et le médiateur de la protection sociale.
Certains grands assureurs comme AG2R La Mondiale ont des filiales qui peuvent dépendre de l’un des trois… Vous trouverez les coordonnées du médiateur sur votre contrat, sur le site Internet (souvent dans les mentions légales) ou dans votre espace client. Si vous venez de souscrire votre contrat, vos remboursements tardent, peut-être, du fait d’un délai de carence.
« Mon reste à charge n’a pas été calculé en fonction du plafond annuel. Du coup, je suis bien moins remboursé. »
Adresser un devis avant de réaliser les soins évite bien des problèmes. Néanmoins, le médiateur de la mutualité constate dans son rapport de 2020 que l’estimation de remboursement transmise et la prise en charge réelle peut différer. Il demande ainsi aux mutuelles d’être « vigilantes lors de l’étude des devis ».
Bien que l’estimation de remboursement ne soit pas un document contractuel, si la mutuelle a donné son accord, elle s’engage à rembourser les soins. Mais elle ne peut évaluer un remboursement qu’en fonction des éléments dont elle dispose au moment de l’estimation.
Si des demandes de remboursement sont en cours de traitement au moment de l’estimation, elle ne peut savoir si vous avez ou non atteint le plafond de remboursement. Aussi, pour éviter tout litige et retard de remboursement, veillez à lui faire passer tous vos devis (dentaires, par exemple) dans le même courrier.
« J’ai contracté une mutuelle pour son remboursement d’audioprothèses à hauteur de 1 700 € par oreille. Mais la prise en charge n’a été que de 150 € par oreille ! »
Ce qui vous a sans doute été expliqué, avec une formulation ambiguë, c’est qu’avec un contrat dit « responsable », et quelle qu’en soit l’option, les appareils de classe II (hors 100 % santé) ne peuvent être remboursés plus de 1 700 € par oreille, en cumulant la prise en charge par l’Assurance maladie et la complémentaire santé. C’est un plafond, rarement atteint, sauf avec les options de contrat les plus chères.
Pour éviter des désagréments et avant de vous engager pour un an, si vous choisissez un contrat pour une prise en charge particulière, demandez par écrit un exemple concret de reste à charge.
« Je ne comprends rien aux règles de résiliation : il n’y a pas un conseiller qui me dise la même chose. Qui croire ? »
Si vous quittez votre mutuelle pour une autre et que vous engagez une demande de résiliation, la mutuelle la refusera, et c’est normal. Depuis le décret du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de contrat de complémentaire santé, appliqué le 1er décembre 2020, c’est à votre future complémentaire d’effectuer la démarche et c’est donc à elle que vous devez vous adresser. Cela permet d’assurer la continuité de la prise en charge, sans faille ni chevauchement, et d’éviter les problèmes de transmission par l’Assurance maladie.
Si vous quittez votre mutuelle sans la remplacer et que vous avez envoyé un courrier, un mail ou un message via le compte client, vous avez eu raison et la mutuelle qui vous réclame un recommandé a tort ! Depuis ce décret, une simple notification suffit. Rappelez-le à votre mutuelle.
Enfin, si votre contrat a moins d’un an… vous ne pouvez pas résilier ! Sauf exceptions (adhésion à une mutuelle d’entreprise obligatoire, déménagement, mariage…), vous êtes lié pour un an, ce n’est qu’au-delà que vous pouvez résilier librement. Attention : on parle bien d’un an de contrat, et non d’adhésion à la mutuelle. Tout changement de garantie, et donc de contrat, fait repartir le chrono pour un an.
« J’ai souscrit sans vraiment le comprendre à une assurance santé et je ne parviens pas à la résilier. Que puis-je faire ? »
Ce cas, plusieurs fois dénoncé par 60 Millions, est celui d’une souscription par SMS après un démarchage en ligne, ouvrant droit à quatorze jours de rétractation. Passé ce délai, l’assuré est lié pour un an, sauf à rentrer dans les cas de résiliation légaux infra-annuels. Ou à faire valoir auprès du service réclamations ou du médiateur un défaut d’information lors de la souscription. Depuis le 1er avril 2022, le démarchage téléphonique en assurance est soumis à une plus forte régulation pour éviter ce type de situation.
Source : 60 Millions de consommateurs
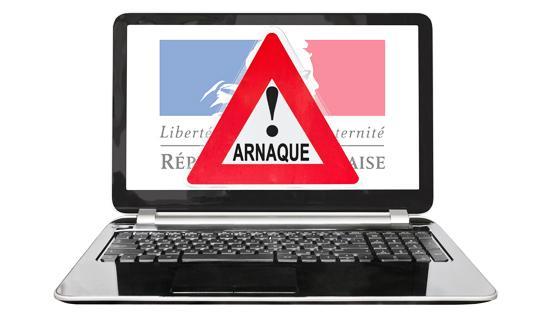
Le 30/04/2023
L'arnaque au faux mail de remboursement des impôts est de retour
La saison des arnaques au remboursement des impôts est ouverte ! Un mail renvoie sur un faux site « officiel » destiné à voler vos données bancaires.
À l’approche du 13 avril, date qui marque l’ouverture de la campagne 2023 de déclaration des revenus, les escrocs sont déjà sur le coup. Des mails reproduisant l’en-tête du site impots.gouv.fr et signé de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) colportent a priori une bonne nouvelle : vous bénéficiez d’un remboursement d’impôt. Et pour le recevoir, il suffit de remplir un formulaire. Attention, il s’agit d’une arnaque.
Des indices qui doivent vous alerter
« Nous avons le plaisir de vous informer que suite à notre traitement de votre déclaration de revenus, nous avons calculé que vous avez droit à un remboursement d’impôt d’un montant de 115,49 € », annonce le message que 60 Millions a reçu.
Il est demandé de cliquer sur un lien afin de « nous assurer que les informations que nous avons concernant votre compte sont correctes ». Il renvoie vers un site imitant le site impots.gouv.fr et comportant un questionnaire où il est demandé de rentrer ses coordonnées bancaires.
Si vous recevez ce mail, dont le montant du remboursement promis peut être plus ou moins important, plusieurs indices doivent vous mettre la puce à l’oreille. Le plus flagrant est l’adresse électronique de l’expéditeur, dans notre cas « 406900938540[at]surview.ae ». Ce type d’adresse farfelue est le signe évident d’une tentative de phishing (ou hameçonnage, un genre d’escroquerie pratiquée sur le Web).
Mais attention, les escrocs ont peaufiné leur technique et peuvent aussi créer des adresses très proches de celle des vrais services du fisc. Parfois, cela se joue à une lettre près. Vigilance, donc !
Un doute ? Des outils pour vérifier et signaler
Un mail identique ou ressemblant arrive dans votre boîte mail ? N’y donnez pas suite, n’ouvrez surtout pas de pièce jointe et signalez le message suspect via Signal Spam ou Pharos, la plateforme dédiée à la lutte contre les contenus illicites sur Internet. Si vous recevez ce message par SMS, transférez-le au 33700.
Face à tout message suspect, reçu par mail ou SMS, un outil de diagnostic gratuit est aussi disponible en ligne 24h/24 sur Cybermalveillance.gouv.fr.
N’hésitez pas non plus à contacter directement les services fiscaux depuis votre espace personnel sur impots.gouv.fr ou en appelant le 0809 401 401 (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, service gratuit + coût de l'appel).
En cas de doute sur le contenu du message reçu, rappelez-vous qu’une administration (impôts, CAF, Sécurité sociale…) ne réclame jamais de coordonnées bancaires par mail ou SMS pour effectuer un remboursement.

Le 27/04/2023
Baisser le tarif de votre assurance auto
En constante augmentation, l’assurance auto pèse lourd dans le budget. Voici quatre pistes à exploiter pour économiser des centaines d’euros par an.
Impossible d’y échapper. Même si votre véhicule ne roule pas, l’assurance auto est obligatoire. Et elle coûte cher, entre 700 et 800 € par an, avec une augmentation tarifaire de 2 % chaque année en moyenne ! Une fatalité ? Non, à condition de vous plonger dans votre contrat et de reprendre la main. Zoom sur les quatre leviers qui peuvent faire baisser la facture.
1. Réduire le montant de la prime
Comparez votre contrat à des offres équivalentes chez des assureurs concurrents afin d’identifier les plus avantageuses. Vous aurez ainsi toute légitimité à réclamer un effort de la part de votre assureur, même si les marges de négociations restent faibles. « La tendance demeure à l’augmentation globale des assurances ces dernières années et de gros rabais sont difficilement envisageables », précise le comparateur d’assurances Lelynx.fr.
2. Réviser ses garanties
Utilisez-vous bien toutes les garanties présentes dans votre contrat ? Réaliser un état des lieux de vos besoins peut « faire vraiment baisser la note », indique LeLynx. Si vous venez d’opter pour un garage fermé individuel, pensez à le signaler à votre assureur. La diminution du risque de vandalisme influe sur le montant de la prime : 596 € par an, en moyenne, pour une voiture garée à l’abri contre 685 € par an, en moyenne, quand elle dort dehors.
De même, un déménagement dans une région où le trafic est moins dense, et donc le risque de sinistralité moindre, mérite d’être reporté : une assurance auto coûte en effet 708 € par an, en moyenne, en Ile-de-France contre 533 € en Bretagne. Soit 175 € de différence.
3. Adapter son contrat
Avez-vous encore besoin d’une assurance tous risques ? Si votre voiture a déjà quelques années et décote beaucoup à l’Argus, peut-être est-il temps de passer à une formule au tiers. Le montant des réparations étant indexé sur la valeur du véhicule, la souscription à un contrat tous risques peut se révéler inutile si votre voiture cote à 2 000 ou 3 000 €.
Attention : vous ne serez pas couvert en cas de rayures ou de dégâts légers n’ayant pas d’impact sur la sécurité. Comptez 733 € par an en moyenne pour une formule tous risques contre 527 € pour une formule au tiers. Autre option : relever le montant de la franchise pour économiser sur la prime annuelle, avec en contrepartie un reste à charge plus élevé en cas de sinistre.
4. Changer de formule
Si vous roulez peu, moins de 5 000 km par an, un contrat dit « au kilomètre » peut se révéler judicieux : ces formules sont entre 25 et 30 % moins chères qu’un contrat classique, à condition de respecter le kilométrage annuel maximal autorisé. La facturation est composée d’un coût fixe pour assurer le véhicule à l’arrêt et d’une facturation au kilomètre qui varie selon l’utilisation. En cas de dépassement du plafond, chaque kilomètre supplémentaire est facturé plus cher.
Ce type de contrat implique l’installation d’un boîtier pour suivre la distance parcourue. Autre option : l’assurance au forfait 24 heures, telle Wilov, qui – en plus d’un coût fixe de base – se déclenche uniquement lorsque vous roulez et ne limite pas le nombre de kilomètres à l’année. Une belle économie pour les automobilistes dont la voiture reste souvent au garage.
Source : 60 Millions de consommateurs 04/2023

Le 19/04/2023
Obsèques : déjouez les pièges des profiteurs
Banques, assurances, sociétés de pompes funèbres… Inutile de passer par eux pour soulager vos proches en prévoyant et finançant vos funérailles.
Votre mort leur va si bien. Assureurs et banquiers collectent chaque année 1,5 milliard de cotisations auprès des cinq millions de Français ayant souscrit un contrat d’assurance obsèques, un produit pourtant très dispensable. Quant aux pompes funèbres, la concentration à l’œuvre sur ce marché de 2,5 milliards d’euros annuels ne favorise ni la transparence ni la sobriété.
La mort est un sujet tellement sensible que l’émotion l’emporte souvent sur la raison, à l’heure de la disparition. Y penser par anticipation ne fait pas mourir pour autant ! Et préparer tout à l’avance, sereinement, permet surtout d’enlever toute pression et toute interrogation de la part des proches qui vous survivront.
Contrat d’assurance en capital : gare au coût
Vous voulez avoir la certitude que vos proches n’auront pas à payer vos funérailles ? Pas sûr pour autant que cela vaille la peine de souscrire un contrat d’assurance obsèques en capital. Le principe est simple : à votre décès, la banque ou l’assureur versera le capital de cette assurance-vie au(x) bénéficiaire(s) que vous aurez désigné(s). Son usage est exclusivement réservé au financement de ces frais : les fonds seront débloqués sur présentation de la facture.
« Ce type de contrat donne souvent accès à un numéro d’assistance à appeler lors du décès, précise Ophélie Chauffert, présidente de l’association Je choisis mes pompes funèbres, par ailleurs directrice du réseau de pompes funèbres indépendant Funeris. Un conseiller peut alors orienter les proches vers des sociétés partenaires, avec lesquelles le banquier ou l’assureur a mis en place un système de tiers payant. C’est une manière d’infléchir le choix de la famille. Mais elle reste libre d’opter pour n’importe quelle autre entreprise de pompes funèbres. Si nécessaire, elle peut demander à cette dernière d’accorder un délai de paiement jusqu’à ce que le capital ait été versé » (sous quinze à trente jours, généralement).
Épargnez plutôt de votre côté
Le montant mensuel de la cotisation dépend du montant du capital choisi (4000 €, par exemple) ; de l’âge de souscription (plus vous êtes âgé, plus c’est cher) ; mais aussi du type de contrat : à durée de versements prédéfinie, de cinq à vingt ans ; ou viager, pour lequel vous paierez chaque mois jusqu’à votre décès. Pour un contrat de dix ans souscrit à l’âge de 62 ans garantissant un capital de 4000 €, que vous mourriez avant ou après l’échéance de ces dix années, comptez une cotisation de 40 à 50 € par mois, soit entre 4800 et 6000 € au total.
Fin 2019, une étude montrait qu’un souscripteur de 62 ans verse, en moyenne, 5870 € pour un capital garanti de 4000 €. En résumé, pour faire une bonne affaire, vous avez intérêt à mourir tôt. Est-ce ce que vous souhaitez ?
Surtout, est-ce nécessaire ? Après votre décès, jusqu’à 5600 € pourront être prélevés sur vos comptes pour les frais d’obsèques. Il sera plus avantageux de verser quelques dizaines d’euros par mois sur un compte d’épargne. Il faut à peine huit ans de versements mensuels de 40 € sur un livret A pour constituer un capital de 4 000 €, intérêts compris. Certes, il ne faut pas mourir avant, mais vous n’aurez pas payé de cotisations d’assurance à perte.
Assurance obsèques en prestations : gardez votre liberté
À la différence d’un contrat en capital, le contrat en prestations prend en charge le financement mais aussi l’organisation des funérailles. Il repose sur deux contrats complémentaires :
Une assurance-vie par laquelle l’assureur s’engage à verser, au décès de l’assuré, le capital à l’opérateur funéraire désigné comme bénéficiaire ;
Un contrat de prestation d’obsèques qui décrit les produits et services funéraires qu’une entreprise de pompes funèbres s’engage à réaliser, dans le respect des volontés que vous aurez exprimées : déroulement de la cérémonie, choix du cercueil…
Précision importante : vous restez totalement libre de changer de prestataire à tout moment.
Confiez vos volontés
Là aussi, posez-vous la question de savoir si vous avez vraiment besoin de ce type de contrat. Vous pouvez tout aussi bien écrire, dicter ou enregistrer vos volontés concernant l’organisation de vos funérailles et confier ce document à plusieurs personnes de confiance. Inutile, en revanche, de le déposer chez le notaire avec votre testament, qui ne sera ouvert que plusieurs semaines après votre décès.
Indiquez si vous voulez être incinéré(e) ou inhumé(e) et ce qu’il conviendra de faire de vos cendres ou de votre cercueil. Précisez aussi si vous souhaitez que votre corps reste à domicile ou soit transféré en chambre funéraire, le type de soins (toilette et/ou thanatopraxie), la liste des personnes à informer, le déroulé de la cérémonie…
Prévoir votre repos éternel : prenez vos directives
En cas d’inhumation : indiquez dans quel caveau vous souhaitez être inhumé. Si vous n’en disposez pas, vous pouvez, avant même votre décès, acheter une concession pour une durée définie (trente ans, par exemple) dans le cimetière de votre lieu de résidence (ou ailleurs sous réserve de l’acceptation par la mairie) et y faire aménager un monument funéraire.
En cas de crémation : l’urne peut être inhumée dans une sépulture ou scellée sur un monument funéraire ; déposée dans la case d’un columbarium au cimetière ; ou bien encore enterrée dans une propriété privée (mais il est interdit de la conserver à l’intérieur d’une maison). Il est possible de disperser les cendres, soit dans le jardin du souvenir aménagé dans le cimetière, soit en pleine nature, y compris dans la mer mais pas dans un cours d’eau. En attendant, le crématorium conservera les cendres pendant un an maximum.
Chambre funéraire : pas une obligation
Quel que soit l’endroit où vous décéderez, le passage par une chambre funéraire, qui coûte autour de 500 €, sera facultatif. En cas de décès à domicile ou en Ehpad, votre corps pourra demeurer dans la chambre durant le laps de temps avant la mise en bière et les obsèques, soit six jours hors dimanches et jours fériés.
Il pourra également rester, gratuitement, dans le reposoir de l’Ehpad, si ce dernier en est équipé, et si vos proches y consentent. De nombreux établissements préfèrent toutefois que les corps soient transférés dans une chambre funéraire, hors les murs. Mais pour cela, sauf exception, ils doivent obtenir l’accord de la famille. Et ils sont tenus de payer l’intégralité des frais de transport et de séjour, quelle qu’en soit la durée.
En Ehpad, ce n’est pas aux familles de faire la demande
Pour se soustraire à cette obligation, des Ehpad incitent les proches à appeler une société pour demander le transfert. La facture sera alors à la charge de la famille ! « Si le directeur de l ’Ehpad souhaite que le corps repose ailleurs et que les proches ne s’y opposent pas, ces derniers doivent impérativement le laisser organiser lui-même le transfert », insiste Michel Kawnik, le président de l’Association française d’information funéraire (Afif).
« Et même dans ce cas, ils doivent vérifier que l’autorisation de transfert avant mise en cercueil qu’ils devront signer ne précise pas que les signataires s’engagent à régler tous les frais, poursuit-il. Ils doivent, au contraire, demander à ce que soit indiqué “Transfert effectué à la demande du directeur, sans frais pour les familles”. » Vos proches devront demander à la société de pompes funèbres de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la conservation du corps avant la mise en bière.
Si le décès a lieu à l’hôpital, sachez que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d’une chambre mortuaire dès lors qu’ils enregistrent au moins 200 morts par an. C’est gratuit pendant les trois premiers jours. Si le décès a lieu dans un établissement qui n’en est pas équipé, les frais de transport et de séjour dans une chambre funéraire sont à sa charge pendant trois jours. Là aussi, c’est au directeur d’en faire la demande, pas à la famille, sous peine de devoir payer la facture.
Pompes funèbres : une affaire d’options
Seules certaines prestations des pompes funèbres sont obligatoires : la fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps ; un cercueil avec quatre poignées et une plaque d’identité ; les opérations nécessaires à l’inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres). Tout le reste est optionnel.
Vous êtes libre, par exemple, de demander à des proches de porter le cercueil du corbillard au caveau ou au crématorium. Ou bien encore de ne pas faire procéder à des soins de conservation. Encore une fois, pour éviter à vos proches d’avoir à prendre des décisions post-mortem, faites connaître vos choix de votre vivant. Dans tous les cas, au moment du décès, vos proches auront tout intérêt à faire établir au moins deux ou trois devis, qui seront établis selon un modèle type légal.
Source : 60 Millions de consommateurs 01/2023

Le 17/04/2023
La Banque postale impose de nouveaux frais bancaires à ses clients
La Banque postale a annoncé le gel de ses tarifs bancaires pour 2023. Sauf qu’elle a ajouté de nouveaux frais l’année dernière. Et ils passent mal.
Nul n’est censé ignorer la loi… ni la brochure tarifaire de sa banque ! Ce pourrait être en substance la réponse de La Banque postale à ses clients qui s’étonnent de se voir frapper de nouveaux frais bancaires pour le moins surprenants.
« Je suis titulaire d’un compte à La Banque postale depuis soixante ans environ sans avoir eu de découvert, nous écrit Pierre. Des frais de gestion de découvert ont été prélevés d’office sur mon compte ! » Même constat amer pour Marie-France : « J’ai été surprise de payer pour un forfait de découvert… même si je ne l’utilise pas, puisque je n’ai eu aucun découvert sur l’année. »
Une information préalable passée inaperçue
Comme Pierre et Marie-France, de nombreux clients de La Banque postale ne décolèrent pas et nous le font savoir. Courant novembre, un prélèvement automatique de 6 € est intervenu sur leur compte chèque postal (CCP). Le motif ? L’application de nouveaux « frais de gestion de l’autorisation de découvert », appliqués aux détenteurs de compte. Et ce, qu’ils aient l’utilité ou non de leur découvert autorisé.
Ces nouveaux frais ont été instaurés en catimini. « C’est sorti dans le fascicule des frais 2022, paru en début d’année. Mais qui le lit ? », tempête Francis. Ils ne figurent pas dans le « document d’informations tarifaires », qui résume en deux petites pages les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte de paiement.
En revanche, ils sont bien présents dans la brochure annuelle de la banque, qui ne comptabilise pas moins de 28 pages ! Pis, l’information est noyée parmi toutes les autres. Elle apparaît à la page 16, dans le chapitre « découverts et crédits »… Autant dire que le nombre de clients ayant eu le courage d’aller jusque-là ne doit pas être énorme.
Le tardif rappel de La Banque postale
La brochure apporte deux autres indications sur ces nouveaux frais, évidemment sous forme de renvoi de bas de page en petits caractères. La première : elle sera appliquée à compter du second semestre 2022. La seconde : ces frais de gestion de découvert ne seront pas prélevés si le montant de l’autorisation de découvert est inférieur ou égal à 300 €, pour les 18-29 ans quel que soit le montant.
La Banque postale a attendu novembre 2022 pour sonner le tocsin : les clients concernés ont reçu un message les informant du prélèvement imminent de ces 6 € pour chaque compte. Une information tardive qui en a surpris plus d’un. Surtout qu’y est indiquée la solution pour échapper à ces nouveaux frais : abaisser le montant de l’autorisation « à 200 € ou moins ». Une manipulation assez simple à réaliser sur ordinateur ou sur mobile depuis l’espace client en ligne de la banque. Mais beaucoup moins facile pour les gens peu à l’aise avec le numérique, qui se trouvent contraints de se déplacer aux guichets pour rectifier le tir.
La Banque postale était-elle hors des clous concernant l’information préalable à ses clients sur ce changement majeur de tarification ? « Non, puisqu’en cas de modification des tarifs, les banques doivent en avertir leurs clients sur un support papier ou durable (courriel par exemple) au moins deux mois avant la date d’application (article L. 314-13 IV du code monétaire et financier) », explique Corinne Lamoussière-Pouvreau, juriste à l’Institut national de la consommation (INC, éditeur de 60 Millions). « La brochure tarifaire parue ou mise à disposition en format papier aux guichets avant le 1er janvier 2022 peut être considérée comme un support durable. »
Remboursement pour les uns, double peine pour les autres
Pour les clients ayant réagi à temps et abaissé ou annulé leur autorisation de découvert, l’histoire se termine plutôt bien. « J’ai demandé l’annulation en novembre, et je viens de recevoir 4,87 € le 6 décembre. Je réclame désormais la différence », nous raconte Marie. Jean-Claude a eu plus de chance : « Après avoir réclamé au plus haut niveau, je viens d’obtenir le remboursement en trois fois sur le même relevé bancaire : 6 € sur une première ligne, puis 5,87 € sur une seconde, puis 0,13 € sur une troisième. Donc remboursement double ! »
En revanche, c’est la double peine pour les clients ayant besoin d’un découvert autorisé supérieur ou égal à 300 €. Non seulement ils doivent s’acquitter désormais de ces 6 € annuels censés couvrir les frais de gestion de leur découvert. Mais en plus, s’ils tombent dans le rouge, le découvert leur est facturé à un taux d’intérêt de 16 %, avec un minimum de 1,50 € par trimestre. Cela fait cher le dérapage budgétaire ! Sans parler des frais qui s’ajoutent en cas d’incident de paiement (commission d’intervention, lettre d’information…).
+36 % de frais annuels pour ceux qui en ont besoin
Pourtant, La Banque postale dit s’engager « en faveur du pouvoir d’achat de ses clients » : elle a annoncé « le gel de ses tarifs bancaires en 2023 pour l’ensemble de ses clients ». Ce qui n’est pas faux, sauf que ses nouveaux frais de gestion de découvert ont fait bondir la note en 2022.
Exemple avec un compte souscrit hors pack de services : de 16,80 € par an (1,40 € par mois), les frais totaux passent à 22,80 € en ajoutant ces fameux frais de gestion du découvert. Soit une augmentation rondelette de… 36 % ! Une inflation difficilement justifiable dans le contexte actuel de hausse généralisée des prix.

Le 08/04/2023
Épargne
Comprendre l’inflation et s’en protéger
L’inflation s’est faite plutôt rare ces dernières décennies, si bien que l’on en a oublié les méfaits. Pourtant, elle ronge le pouvoir d’achat, mais aussi le patrimoine. Il est donc crucial pour l’épargnant de comprendre ce mécanisme et de prendre des mesures pour s’en prémunir.
Quiconque suit son budget avec un minimum d’attention l’aura évidemment remarqué : l’inflation galope ! Selon les derniers chiffres publiés par Eurostat, l’organisme statistique européen, la hausse des prix a atteint 10,6 % sur un an dans la zone euro, en octobre 2022. Du jamais vu depuis les années 1970 ! Concrètement, cela signifie que pour acheter un même panier de produits et de services qui valait 100 € à la fin 2021, il faut désormais débourser plus de 110 €. L’argent perd donc de sa valeur avec le temps qui passe. Ces augmentations ne sont toutefois pas réparties de façon homogène. Le coût de certains produits grimpe beaucoup plus rapidement que d’autres. Ainsi, les prix de l’énergie ont bondi de 41,5 %, ceux de l’alimentation, d’environ 13 %, quand ceux des services n’ont pris « que » 4,3 %. Bien sûr, les chiffres diffèrent également selon les États membres de l’Union européenne. Ainsi, la France reste encore relativement « épargnée », à 7,1 % d’inflation globale, alors que les pays baltes connaissent des hausses supérieures à 20 % (voir tableau).
COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
Pour comprendre le phénomène, il faut remonter au début de la pandémie, en 2020. À l’époque, les gouvernements réagissent avec des mesures très généreuses afin de protéger les entreprises et les ménages des effets du confinement. Des masses d’argent inondent l’économie. « Les politiques budgétaires de soutien ont fait augmenter la quantité de monnaie en circulation, créant une croissance post-confinement très forte », analyse Cédric Marc, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Patrimonio Finance. En parallèle, pendant la crise sanitaire, les Français engrangent un surplus d’épargne estimé à 175 milliards d’euros par la Banque de France. Lors du redémarrage de l’économie, fin 2021, une soif de consommation s’empare de nombreuses personnes contraintes depuis des mois. Les usines et les chaînes logistiques, jusqu’alors stoppées ou au ralenti, ont du mal à faire face à cet afflux de demande. C’est notamment vrai pour les productions impliquant la Chine, car ce pays, lourdement touché par le coronavirus, a instauré une politique de confinement très stricte, qui a mis une partie de son économie à l’arrêt. À cette situation de tension s’est ajoutée la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Elle a provoqué une flambée des tarifs de l’énergie, en particulier du gaz. Toutes les entreprises confrontées à une hausse de leurs coûts énergétiques l’ont peu à peu répercutée sur leurs prix. L’inflation s’est alors diffusée dans tous les secteurs d’activité.
POURQUOI EST-CE DANGEREUX ?
Un renchérissement ponctuel ou transitoire n’est pas très grave. Les difficultés apparaissent lorsqu’un « effet de second tour » se met en place. On parle aussi de « boucle prix-salaire », ce moment où les travailleurs, confrontés à une vie plus chère, commencent à réclamer des salaires plus élevés. Quand elles leur ont accordé ces augmentations, les entreprises les répercutent sur leurs prix, ce qui génère de nouvelles demandes salariales, et ainsi de suite. Une fois démarrée, cette spirale est extrêmement difficile à juguler. Il existe cependant une différence notable entre la situation actuelle et la dernière grande période d’inflation, dans les années 1970 : les salaires ne sont plus indexés sur la hausse des prix. Cette boucle est donc moins immédiate. Néanmoins, elle est en train de s’installer ; d’abord aux États-Unis, où le marché de l’emploi est très tendu, mais aussi, progressivement, en Europe.
QUELLES RÉACTIONS DES AUTORITÉS ?
Face au risque de voir l’inflation déraper, les banques centrales ont pris des mesures drastiques. Après des années de politiques monétaires très accommodantes, elles ont commencé à relever les taux d’intérêt. Leur objectif ? Renchérir le crédit pour les ménages et les entreprises, afin de limiter leur capacité d’emprunt et, in fine, de contraindre la consommation. « Il faut détruire de la richesse pour réduire la demande, et ainsi se caler sur le niveau de l’offre, explique Alexandre Hezez, stratégiste de la Banque Richelieu. Cela suppose de monter les taux d’intérêt très rapidement. »
Mais il y a de la casse, puisque cela se fait au prix d’une augmentation des défaillances d’entreprise, donc du chômage, et d’une baisse de la croissance. En la matière, la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine, a frappé tôt et fort, car l’économie des États-Unis a un temps d’avance sur la nôtre. Fin septembre, elle avait déjà majoré cinq fois ses taux courts. La Banque centrale européenne (BCE) lui a emboîté le pas en juillet dernier. Cette hausse des taux d’intérêt à court terme joue sur ceux à long terme, que ce soit sur les taux d’emprunt du crédit immobilier ou sur ceux des marchés financiers. L’État français, qui pouvait s’endetter sur 10 ans à un taux proche de zéro au début de l’année 2022, doit désormais emprunter à un taux d’intérêt flirtant avec les 3 %.
QUEL IMPACT SUR L’ÉPARGNE ?
« L’inflation est le pire phénomène pour l’épargnant, parce qu’elle est destructrice de valeur, et ce à peu près quel que soit le type de placement choisi », alerte Nadine Trémollières, directrice de Primonial Portfolio Solutions. Épargner est un choix rationnel, qui consiste à renoncer à consommer aujourd’hui afin de pouvoir le faire davantage demain. Mais pour cela, l’épargne doit être rémunérée. Selon les produits choisis, l’horizon de placement et le risque pris, cette rémunération sera plus ou moins forte. Par exemple, à fin 2022, le livret A rapporte 2 % ; c’est son rendement nominal. Le problème, c’est qu’en parallèle, les prix augmentent au-delà de 2 %. Le gain se transforme donc en perte, car le rendement réel du placement se calcule en défalquant l’inflation. Or celle-ci se montant actuellement à environ 6 %, le taux réel du livret A ressort à - 4 % !
4 PRODUITS FINANCIERS PASSÉS À LA LOUPE
Si aucun placement n’est épargné par les conséquences délétères de l’inflation, tous ne réagissent pas de la même façon. Certains résistent mieux que d’autres. Revue de détail.
L’épargne de précaution • La plus touchée
Les placements sans risque et de court terme, comme les livrets, sont les premiers atteints par l’inflation car leur rémunération est modeste. « Le plus impacté, c’est le compte courant, car il ne rapporte rien. Et pourtant, depuis le Covid-19, les Français ont épargné des milliards d’euros dessus », constate Stefan de Quelen, directeur général du courtier Meilleurtaux Placement. Les sommes emmagasinées sur ces comptes pèsent 550 milliards d’euros, soit plus que l’épargne placée sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire (LDDS) cumulés. Or, ces derniers sont mieux lotis, car leur taux est réévalué régulièrement en fonction d’une formule de calcul dépendant des taux d’intérêt à très court terme et de l’inflation. Leur rémunération a ainsi grimpé à 2 % en août dernier, et elle devrait encore être majorée lors de la prochaine révision, mi-janvier, puisque ces deux facteurs continuent de croître.
Le fonds en euros • Amélioration en vue
L’actif garanti de l’assurance vie repose à 80 % sur des obligations, ces titres de créances émis par des États ou des entreprises. Bonne nouvelle : avec la remontée des taux, ils offrent une rémunération plus attractive que par le passé. L’argent que les assureurs investissent actuellement vient donc améliorer le rendement du fonds en euros. Mais il ne faut pas s’attendre à des hausses de taux colossales par rapport à 2021 (seulement +1,28 % en moyenne, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). En effet, le fonds en euros est un paquebot qui connaît une forte inertie. Chaque année, seules les obligations arrivées à échéance doivent être réinvesties, soit au maximum 10 % du portefeuille.
L’immobilier • Entre deux eaux
Pour les investisseurs qui font de l’immobilier locatif, en direct ou par le biais de sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI), la période est complexe. Selon Nadine Trémollières, directrice de Primonial Portfolio Solutions, « l’immobilier est la classe d’actifs qui va le mieux s’adapter à l’inflation, car elle a la capacité d’avoir une rémunération indexée dessus ». Mais à condition d’être en mesure d’appliquer ces hausses de loyers… Plusieurs freins existent en effet, et en premier lieu le « bouclier loyer », instauré par les pouvoirs publics, qui plafonne les augmentations à 3,5 % pendant un an. D’autres mesures pourraient être prises si l’inflation s’installe. Autre écueil : la capacité des locataires à payer. Pour un bailleur, mieux vaut négocier une élévation faible que de se retrouver avec un bien vacant. Par ailleurs, « la montée des taux d’intérêt va avoir un impact sur le crédit immobilier. Une partie du marché risque de se fermer au primo-accédant », anticipe Bertrand Merveille, directeur de la gestion privée de La Financière de l’Échiquier. Plus globalement, cette hausse des taux s’accompagne normalement d’une baisse des prix de l’immobilier.
Les actions • Pas immunisées
« La meilleure réponse à l’inflation, ce sont les actions, note Bertrand Merveille. Nous sommes confiants dans la capacité des entreprises à être agiles et à s’adapter à l’environnement économique. » Mais toutes n’en sortiront pas indemnes, car l’inflation entraîne mécaniquement une montée des coûts. Certaines sociétés seront en mesure de la répercuter sur leur prix ; les autres verront leurs marges fondre. Sans compter qu’en Bourse, le climat d’instabilité géopolitique et d’incertitudes économiques fait fuir les investisseurs. Sur les 11 premiers mois de l’année, l’indice des actions internationales a perdu près de 17 % de sa valeur.
De fortes disparités en zone euro
Source : Eurostat (octobre 2022)
Source : UFC QUE CHOISIR 01/2023

Conseils pour déjouer les arnaques lors d’achats en ligne
Le 03/04/2023
Baptiste : "Bonjour, j’aimerais avoir quelques conseils pour déjouer les arnaques lors d’achats en ligne".
Merci pour votre question Baptiste qui soulève 2 réalités : les arnaques en ligne sont de plus en plus nombreuses et les pirates de plus en plus rusés. Il n’est donc pas toujours facile de distinguer le vrai du faux.
Avec la crise sanitaire, les ventes en ligne ont connu une croissance exponentielle, ce qui a réveillé l’appétit des cybercriminels toujours prêts à innover pour mieux arnaquer les consommateurs via des sites de vente douteux, voire malveillants ! C’est pourquoi lors d’achats en ligne, il est nécessaire d’être vigilant et d’adopter quelques bons réflexes pour éviter de tomber dans leurs pièges.
Première chose : se méfier des offres trop alléchantes:
En effet, ces dernières doivent vous alerter et vous poussez à faire un minimum de vérification avant d’acheter. Pour cela, vous pouvez déjà commencer par comparer le prix sur différents sites web. Si le prix est vraiment cassé, il s’agit probablement d’une arnaque donc passez votre chemin.
Deuxième chose : se méfier du nom du site vendeur:
Pour un site e-commerce que vous ne connaissez pas, n’hésitez pas à faire des recherches en tapant dans un moteur de recherche le nom du site vendeur, suivi du mot “arnaque” ou “escroquerie” pour voir s’il a déjà fait l’objet de plaintes. Une autre vérification importante concerne la localisation de la société de vente.
Troisième chose : se méfier sur quel site on commande:
Mieux vaut privilégier des achats sur des sites gérés par des sociétés françaises ou de l’Union européenne. La raison est simple : il existe une réglementation européenne qui s’applique à ces sites en cas de litige et que vous pourrez invoquer. Pour cela, référez-vous aux CGV, conditions générales de vente, et aux mentions légales. Elles se trouvent généralement en bas de page du site.
Quatrème chose : se méfier au moment du paiement
Enfin, si vous arrivez au moment du paiement, pensez à faire 2 vérifications de sécurité en consultant l’adresse du site, c’est-à-dire l’url.
La première consiste à vérifier qu’elle comporte impérativement la mention “https://” et non “http://”. Le -s à la fin est symbole de sécurité qui garantit le chiffrement de vos données bancaires entre votre machine et le site marchand. L’idée est bien d’éviter le piratage de votre carte bancaire. La seconde vérification de sécurité est l’affichage d’un pictogramme en forme de cadenas. Ce dernier indique que le site de paiement est bien sécurisé.
De manière générale, choisissez toujours un identifiant ou un mot de passe solides et différents sur chaque site où vous réalisez des achats.